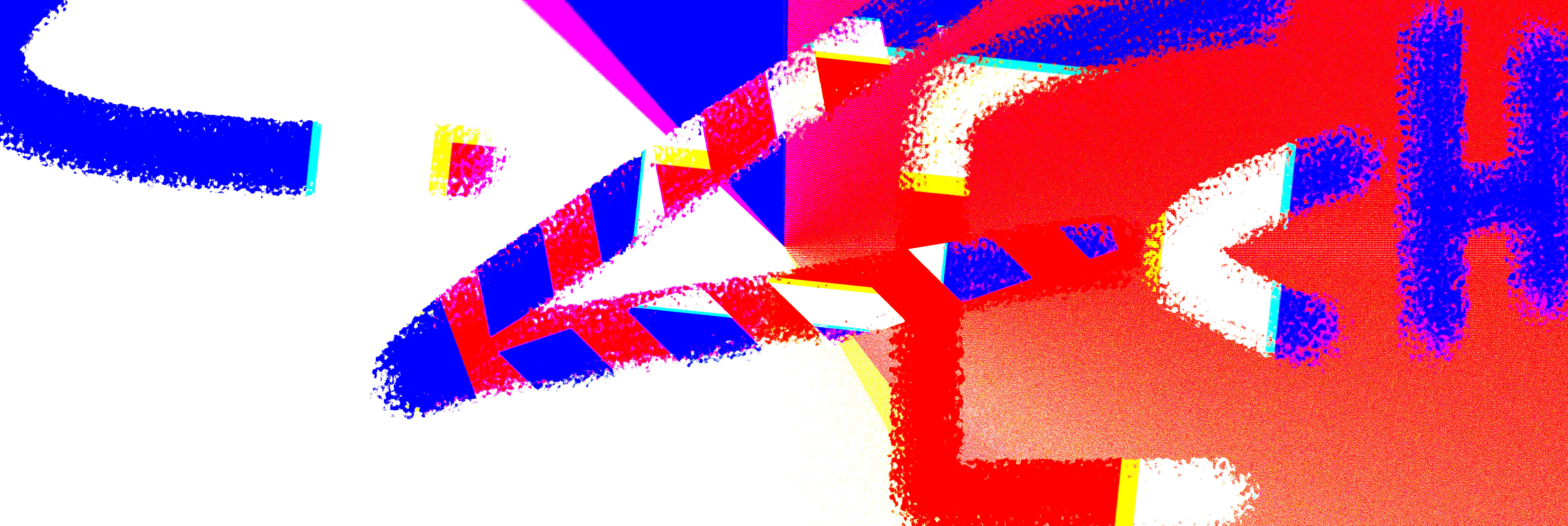ENTRETIEN AVEC VÁCLAV KADRNKA
De quelle manière êtes-vous venu au cinéma ?
J’ai toujours aimé le cinéma mais je ne suis pas tombé dans la marmite tout de suite. J’ai commencé par faire du théâtre, j’étais membre d’une troupe à Zlín, ville d’où je viens et qui a par ailleurs une grande histoire cinématographique. Mon père m’emmenait souvent au cinéma, mais on allait voir ce qu’on pouvait voir, c’est-à-dire la sélection très réduite de la distribution encore sous le régime communiste. Le changement a eu lieu lorsque nous nous sommes retrouvés en Angleterre, toute la famille s’y était exilée et c’est là que j’ai eu plus de temps pour entrer en moi-même. J’y ai commencé à réfléchir de façon plus profonde sur le cinéma, à me passionner pour tout ce qui était accessible, le cinéma de la fin des années 1980. Je suis tombé amoureux des films de Derek Jarman, j’étais fasciné par cette énorme liberté et l’impression qu’il n’y avait pas de frontière, ni de limite, ni de censure. Après la chute du régime dans mon pays, je suis rentré, j’ai fait deux ans à l’école de cinéma de Zlín, où j’ai fait la connaissance du réalisateur Vojtěch Jasný. C’est cette rencontre qui a fini de décider de tout, qui m’a fait comprendre ce que je voulais faire. Cette relation s’est transformée en une grande amitié. J’ai tourné un premier court métrage avec lequel je me suis ensuite présenté à la FAMU. En définitive, sans cet exil, sans ce séjour dans ce monde libre, je n’aurais probablement pas eu cette illumination.
Comment composez-vous avec l’héritage de la Nouvelle vague tchèque ?
Le cinéma est comme un arbre avec de nombreuses branches, mais quelle que soit celle sur laquelle on est assis, il est impossible, même lorsqu’on veut prendre ses distances, d’ignorer le tronc. Si je devais citer un cinéaste qui m’a vraiment influencé, je l’ai déjà dit, c’est Vojtěch Jasný, qui m’a appris à penser par le cinéma, par la lumière, par les sons, par les couleurs. Il avait une méfiance envers le réalisme, il n’hésitait pas à dire ses récits par des moyens qui parfois allaient jusqu’à l’abstraction, et c’est lui qui m’a ouvert à cette façon de voir et d’approcher le cinéma. Mon expérience avec Věra Chytilová, qui a été ma professeure à la FAMU, a été également phénoménale. Nous passions notre temps à nous disputer, mais les retours que j’avais de sa part étaient extrêmement sains et constructifs car elle avait cette capacité à immédiatement percevoir quels étaient les problèmes principaux, à immédiatement chercher le cœur du sujet et à aller au plus profond de son interlocuteur. J’apprécie plus les expériences que j’ai eues avec elle avec du recul que sur le moment, maintenant que j’enseigne à la FAMU car j’ai compris à quel point il est parfois difficile de dire la vérité. Or, elle en avait l’obsession. Les cinéastes majeurs du cinéma tchèque ont véritablement été bâillonnés pendant vingt ans, et les cinéastes tchèques qui ont en quelque sorte usurpé leur place pendant cette période étaient des voies insincères. Pour notre génération, il a donc été difficile de renouer avec ces années de brume. Au début des années 1990, quand on a redécouvert ces films, on a eu besoin de renouer avec eux, c’est-à-dire d’ignorer vingt ans d’évolution. De nombreux cinéastes ont essayé de reprendre ce fil coupé alors que le cinéma était déjà bien ailleurs, donc c’est un cas particulier. Mais il ne pouvait pas en être autrement.
Votre premier long métrage, Eighty Letters, est autobiographique. Il raconte la tentative de votre mère et vous pour rejoindre votre père en Angleterre lorsque vous étiez enfant.
L’idée du film est venue du désir de dire à travers un film une image qui est celle de la mémoire, du souvenir. C’est l’une des propriétés du cinéma d’évoquer les images de la mémoire. J’avais envie d’aborder cette période qui a souvent été évoquée dans le cinéma tchèque des années 1990, en tout cas après 1989, mais en la montrant avec une autre dimension que dans ce qui se faisait habituellement. Ce n’est pas un jugement que je porte sur ces films, certains d’entre eux sont d’ailleurs très bons, mais ils avaient pour la plupart une tonalité légère, or je voulais faire un film dans lequel le spectateur ressentirait le poids de cette période.
La critique évoque souvent votre travail comme une trilogie de l’absence : celle du père dans Eighty Letters et Saving One Who Was Dead mais selon d’autres modalités, celle du fils à la recherche duquel part son père dans Little Crusader. Ce regard sur votre travail est-il une facilité critique ou votre œuvre est-elle délibérément conçue comme telle ?
Ce n’était pas du tout conscient. Chacun de mes films est venu spontanément et naturellement. Il y a néanmoins des thèmes qui me taraudent plus que d’autres et on pourrait trouver des liens latents. Cette appellation est apparue au moment où je commençais à travailler sur mon troisième film, à le pitcher dans des festivals. Mais je dois dire que ça colle : sans l’avoir prévu, il s’agit en effet de trois films sur l’absence de l’être aimé.
Eighty Letters passe par le regard du jeune garçon sur le monde qui l’entoure. Cette question de la perception est au centre de votre travail. Vous avez donc vécu en Angleterre, comme le personnage ; le fait de devoir apprendre à nommer les choses autrement, en anglais, vous a-t-il mené à une plus grande attention à la question de la perception ?
Ce film est effectivement basé sur un regard d’observateur, celui de ce garçon qui est à la fois un personnage et à la fois moi. Il aurait été absurde de couper les deux, de mettre trop l’accent sur la part de fiction. Il n’y a pas dans ce regard uniquement le souvenir que j’avais de cette période mais aussi le vécu des migrants, des exilés, des gens qui sont dans cette situation quelle que soit la période et qui s’apprêtent à partir, à laisser quelque chose derrière eux, et qui emportent ce quelque chose. Je ne voulais pas exprimer cela de façon explicite, ça reste latent, et cette nostalgie infuse. Tout cela passe par le travail avec les objets, avec la langue, avec cette façon de se centrer sur quelques objets précis, comme pour la dernière fois.
Le film semble vouloir montrer la dépense d’énergie, l’effort physique que les démarches administratives liées à la tentative de l’exil nécessitent. Il y a régulièrement des plans sur les personnages marchant à vive allure, de longs travellings notamment sur le garçon en train de se hâter, focalisés sur les jambes.
Oui, et cela souligne d’autant mieux l’impossibilité de ce départ. On les voit bouger sans arrêt mais ils reviennent toujours au même endroit. Lorsque le film a été présenté à Berlin, un critique avait écrit que c’est un film méditatif, mais ce n’était pas du tout mon intention ; je voulais au contraire que le spectateur ressente le poids de cette période et l’impossibilité de cette quête. On peut avoir l’impression que dans mes films, le récit n’est pas au premier plan mais mes personnages sont toujours extrêmement actifs, ils ont une conviction, un besoin de faire, d’agir, de changer ou de redresser quelque chose, même si parfois ils n’y arrivent pas.
Vos films présentent des actions vaines, mais avec des variations à chaque nouvelle tentative. Si les personnages échouent, quelque chose a néanmoins évolué.
Je suis fasciné par l’homme en action, je suis persuadé qu’on peut changer les choses ; on a parfois l’impression que c’est impossible, qu’on se bat contre un mur – parfois dans mes films, les personnages arrivent juste un peu trop tôt ou juste un peu trop tard – mais l’homme en action est vraiment ce qui m’attire le plus. Souvent je suis en désaccord avec certaines analyses de mes films, selon lesquelles ce sont des films non-narratifs. Or, la narration a parfois lieu en arrière-plan ou en hors-champ, ou juste avant ou juste après, un peu trop tôt ou un peu trop tard, mais elle est là.
Vos films travaillent le plan fixe et le découpage, et la question du temps est importante dans votre travail. Par exemple dans Eighty Letters, qui se déroule sur une seule journée, on a le sentiment de vivre en direct avec les personnages. Comment travaillez-vous ce rapport ?
C’est sans doute lié à cette attitude d’observation. Déjà quand j’étais petit, j’adorais observer les choses, ça ne m’ennuyait pas du tout de faire la queue longuement pour recycler les bouteilles ou à la Poste, au contraire je pouvais passer des heures juste à regarder ce qui se passait autour de moi. La perception du temps devient alors un flot subjectif et ce qui m’intéresse est de le représenter. Le plus évident, c’est dans mon troisième film. Vous avez peut-être eu aussi cette expérience : quand on est confronté à une situation grave, traumatisante, c’est comme si le temps s’écoulait autrement, comme si le flot du temps avait un autre rythme et cessait d’être linéaire.
Votre deuxième long métrage, Little Crusader, se déroule au Moyen Âge et est inspiré d’un poète tchèque du XIX ème siècle. Il inverse le postulat de votre film précédent, en envoyant un père à la recherche de son fils.
L’émotion centrale dans ce film concerne la question de la paternité, de la parenté, et ce sentiment d’une certaine vanité, de quelque chose qui nous échappe et qu’il faut peut-être laisser s’enfuir à un moment, accepter leur finitude.
Le film se déroule donc à l’époque médiéval, mais il a été tourné avec une image numérique très définie, ce qui peut provoquer une sorte d’étrangeté : voir une époque révolue depuis longtemps mise en scène et reconstituée avec une technologie très actuelle. Comment avez-vous pensé l’époque du film et réfléchi à sa représentation ?
On s’imagine le passé comme derrière un voile, embrumé, peut-être un peu sale. C’est particulièrement valable pour le Moyen Âge : on pense que ce sont des temps des ténèbres, des temps sombres. Ça ne me semble pas complètement logique. En tout cas je ne voulais pas représenter le Moyen Âge de cette façon. D’ailleurs, si le poème se situe au XIII ème , il est écrit avec une langue qui est celle du romantisme tardif, avec une vision déjà très moderne. Pendant la préparation du film, j’ai fait des recherches, parlé avec des médiévistes qui me disaient que ce n’était pas un monde sale ou sombre ; au contraire, c’était le temps de la lumière, avec des grandes avancées en matière de théologie mais aussi des découvertes qui ont fait évoluer le regard que l’homme portait sur le monde. Bref, il n’était pas question que je représente ce Moyen Âge derrière un voile de brume mais au contraire comme un monde extrêmement propre, un monde de blancheur et de lumière, également pour lui donner une allure de livre pour enfants, de livre saint, et avoir une évolution selon laquelle le film devient au fur et à mesure de plus en plus diaphane. Et je voulais que la mise au point, lors des prises, soit en même temps sur le père et sur l’arrière-plan, sur l’espace ; car l’espace reflète le for intérieur du personnage.
Little Crusader comporte plusieurs moments de théâtre. Or, vous l’évoquiez plus tôt : vous avez d’abord été attiré par le théâtre. Quelle influence a cette expérience sur votre rapport à la mise en scène ?
Pour moi, le théâtre et le cinéma n’ont rien à voir. Dans ma pratique cinématographique, j’essaye le plus possible d’aller contre ce qui est le propre du théâtre. Dans Little Crusader, c’est un peu autre chose : le théâtre est un motif intégré au film. On est dans la tentative du père de rattraper le fils mais le fils est déjà mythifié, il est déjà entré dans la légende, il a déjà son effigie, on le représente au théâtre, dans des fresques, il est chanté, et le père n’arrive pas à l’accepter. Cela revient à la question du passage du temps. Un autre motif important du film, ce sont les tissus, les draperies que l’on voit un peu partout.
Le fait de faire du cinéma à l’encontre du théâtre passe-t-il par l’importance accordée au visuel ?
Oui, et le processus de préparation de ces films est assez parlant à cet égard. Lorsque je commence à rédiger des premiers jets, mes scénarios sont souvent extrêmement bavards, un peu comme quand on écrit une pièce de théâtre, parce que l’espace de la scène n’est pas primairement important, mais au fur et à mesure que j’essaye de visualiser ce que sera le film, l’image et le son, plus que la parole, sont porteurs de sens qui nous arrive plus vite que les mots, qui sont en quelque sorte en retard et deviennent superflus. C’est à ce moment-là que je commence à réduire les mots. Dans la phase de préparation, je travaille avec un peintre, Daniel Pitin, qui m’aide à avoir une vision du film. C’est en préparant ce film que je me suis aperçu à quel point le cinéma, ce sont de la lumière et des ombres, qui véhiculent le mouvement et donc l’émotion. Pour mon troisième film, Saving One Who Was Dead, j’ai carrément fait un scénario de lumière, en déterminant les ambiances lumineuses à tel ou tel moment du film. Lors de la préparation du film, je voulais que la part belle soit donnée aux couleurs, avec le plus de couleurs possible. Une des particularités du film est que, dans différentes scènes, on a la même configuration avec le père allongé au milieu, la mère et le fils de chaque côté, donc il était important de jouer avec les stries de lumière et les ombres afin que le film ne soit pas statique. Les spectateurs savent reconnaître d’après la lumière qu’il s’agit du matin, il n’est pas nécessaire de faire un plan avec le soleil qui se lève et les oiseaux qui chantent, il suffit de choisir la bonne tonalité de lumière.